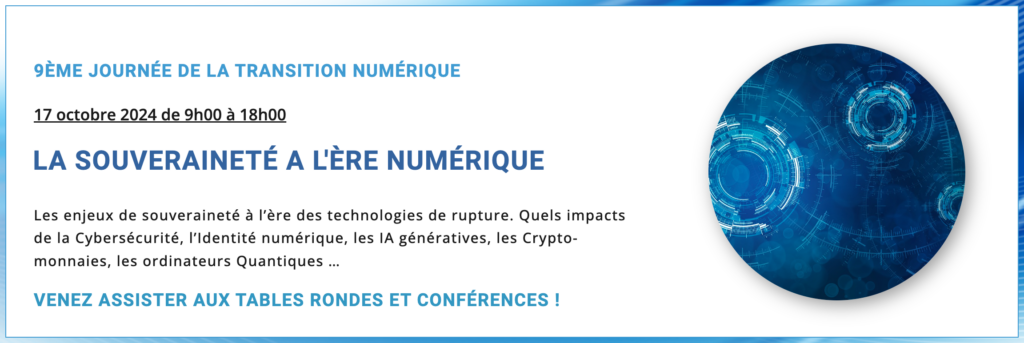Newsletter n°59 - 19 mai 2023
⭕️ Éditorial
Grand causou, petit faisou
Quand nous sommes enfants, certaines des paroles de nos ainés deviennent au fil des années comme des mantras. En psychologie, on parle d’introjections, processus par lequel des choses qui sont en dehors vont peu à peu être à l’intérieur de soi. Ces introjections sont l’héritage familial immatériel, celui qui forge notre rapport au monde, en adéquation avec les pensées entendues, ou en opposition. Un de mes anciens mentors m’avait ainsi dit un jour que s’il était toujours en retard, c’était pour satisfaire sa mère. Quand il était enfant, elle lui demandait sans cesse de se dépêcher, et petit à petit, il s’était forgé l’idée qu’il ne la satisfaisait jamais autant que s’il faisait les choses au dernier moment, ce qui le forçait à se dépêcher.
Si je le soupçonne de s’être moqué de moi, il n’en reste pas moins que, comme tous, ce que j’ai entendu dans mon enfance a participé à ma construction. Et s’il est bien une chose que j’entendais souvent dans ma famille, depuis mes grand-parents maternels jusqu’à mes parents, tous bretons, c’est le leitmotiv « Grand causou, petit faisou« . Ces quatre mots-là ont assurément façonné mon rapport au monde comme « Il faut savoir se retrousser ses manches » est à la base même de ma détestation des chemises à manches courtes. À l’heure où les choses vont si vite, il est bon d’observer que la transmission intergénérationnelle continue à faire son œuvre. On ne grandit jamais aussi bien qu’en apprenant de nos ainés, c’est l’essence même de l’humanité, un continuum qui fait honneur à l’expérience et à la connaissance.
Or, depuis quelques années, comme tant d’autres, je suis consterné par l’incroyable place donnée aux causous dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ceux-là n’ont pourtant pas (encore) fait grand-chose de leur vie. Ce sentiment est renforcé par une expérience de plus d’un quart de siècle auprès de très nombreux faisous (professionnels ou experts), qu’on entend trop peu causer. Conséquemment, parce que les convictions et les certitudes se fondent sur l’inexpérience, l’influence des premiers dans des décisions structurantes de notre pays conduit à de graves difficultés. Pourtant les seconds sont ceux, hommes et femmes, qui, sans le moindre doute possible, peuvent aider à guider, à condition qu’on leur accorde enfin la place qu’il est la leur.
Aujourd’hui nous avons l’honneur de partager avec vous un échange passionnant avec Arnaud Montebourg, avocat, ancien ministre et désormais chef d’entreprise, qui nous présente son Podcast « Les Vrais Souverains«

Un entretien conduit par Sébastien Tertrais
Arnaud Montebourg, avocat, ancien ministre et depuis 2018 entrepreneur, vient de produire un podcast nommé « Les Vrais Souverains », dont deux premiers épisodes sont déjà disponibles.
Dans le premier il retourne à la rencontre des anciens salariés d’Alstom à Belfort, entreprise rachetée par Général Electric en 2015 pour un montant de 13 milliards de dollars, dans le cadre de tractations révélatrices de la capacité de prédation de l’économie américaine et de l’importance de la loyauté des dirigeants des grandes entreprises françaises, dans le second il va à la rencontre de Horizom, un producteur de bambous, une plante magique qui pourrait contribuer à la séquestration du carbone et aux objectifs d’augmentation de la biomasse. Plus tôt en mars nous avions suivi avec beaucoup d’intérêt la commission d’enquête parlementaire liée à la perte d’indépendance énergétique de la France et l’audition de l’ancien ministre, dont nous avions d’ailleurs diffusé deux extraits percutants sur la notion de souveraineté. Nous avons naturellement pris attache auprès de ses collaborateurs afin de nous entretenir avec lui autour des enjeux de souveraineté. Nous avons le plaisir de vous partager ci-après l’entièreté de notre conversation, réjouissante et des plus motivantes.
ST : Après votre premier métier d’avocat, vous vous êtes engagé dans une carrière politique de haut rang, puis vous avez quitté votre mandat en 2015. Vous êtes désormais entrepreneur. C’était important pour vous d’entreprendre ?
AM : Oui, parce qu’il y a l’indépendance et la liberté qui sont liées à mon tempérament et à mon histoire. C’était un vieux rêve, que je voulais réaliser depuis que j’étais étudiant, que je n’ai pas pu réaliser avant parce qu’il fallait aller travailler. J’étais juriste, et finalement la meilleure profession qui correspondait à mon tempérament et à ma carte d’identité intellectuelle c’était avocat, pour exercer en artisan solitaire. J’ai exercé ce métier pendant 7 ans, puis l’action politique m’a rattrapé. J’ai été élu à 34 ans et après je suis parti pour 20 ans, avec un parcours qui devait aller au bout, donc je suis allé au bout du parcours. Après, à 53 ans, je me suis dit que je devais pouvoir réaliser mes rêves.
ST : Vous avez quitté le projet de gouvernement avec Manuel Valls à la suite de désaccords sur plusieurs sujets, sont-ce eux qui vous ont motivé à « y aller » ?
AM : J’ai toujours été en désaccord avec les socialistes, mais dans l’exercice du pouvoir les désaccords ne sont plus théoriques, ils concernent la vie des gens, donc on a envie d’infléchir le cours de la force des choses, en se battant de l’intérieur, ce que j’ai fait. Mais j’ai compris au bout de nombreux combats perdus que c’est vain. À un moment j’ai su dans ma tête que j’avais déjà fait mes cartons. Pour un ministre de l’économie demander une inflexion majeure de la politique économique c’est quand même assez original. Tout cela a été maquillé derrière la fameuse cuvée du redressement, mais franchement la cuvée du redressement n’était rien à côté du réquisitoire que j’ai prononcé ce jour-là contre la politique économique que j’étais obligé d’appliquer, contre laquelle j’étais en désaccord. Lorsque je suis parti j’ai ressenti un grand soulagement.
ST : Cela vous a permis de sortir d’une situation de tension et de vous engager dans un combat pour lequel vous étiez prêt. Il est de notoriété publique que vous avez un certain attachement à la notion de vérité et qu’elle n’a pas été sans impact sur vos différents engagements.
Cette relation à la vérité, qui existe chez Pierre Mendes France, et qui m’avait été bien transmise par mon père, jeune militant radical qui s’était engagé derrière cet homme d’Etat, m’a beaucoup marqué. Dans la « République Moderne », qui est un livre qui a mon âge, Mendes France consacre un passage entier à la question de la vérité comme outil de résolution des problèmes communs. Il est évident que ne pas faire trop de concessions sur la vérité est un point central pour qui veut agir pour son pays. On peut faire de la politique pour d’autres motifs que celui de soutenir son pays, mais moi c’était ce que je cherchais. Le reste ne m’intéressait finalement qu’assez peu, l’essentiel était là.
ST : Un des cadres de la DREETS[1] me disait récemment qu’un homme politique ne parlait jamais aussi bien que lorsqu’il n’avait plus de mandat.
AM : Il est vrai que lorsque nous relisions certains interviews mes attachés de presse me disaient parfois qu’il fallait revoir certains passages, en affirmant que ça ne passerait pas. Je refusais, je ne pouvais pas faire trop de concessions. La manière de les dire pouvait être un peu corrigée, sur la forme il pouvait être fait des choses, mais quand il s’agissait des contenus je ne préférai ne pas trop transiger. J’ai par exemple défendu la filière nucléaire, après Fukushima, dans un gouvernement de coalition avec les écologistes, j’ai lutté contre la bêtise des critères maastrichtiens de Bruxelles, j’ai dit aux dirigeants du CAC 40 qui trahissaient la France qu’ils se comportaient comme des flibustiers, j’ai soutenu le Made in France contre les ricanements de la classe dirigeante, mais ça n’est pas grave, il en reste quelque chose aujourd’hui.
ST : Vous venez de publier deux premiers épisode de votre Podcast « Les Vrais Souverains [2]», et après leur écoute je constate quelque chose de très marquant. Dans le premier, par exemple, vous êtes retourné voir les anciens de Belfort sur le site de General Electric, qui a racheté Alstom en 2015. Il s’agit de syndicalistes qui se sont mis à agir. Ils sont passés d’une logique de contestation et d’une grande déception à celui de l’action. Pensez-vous qu’il y a ici quelque chose à jouer ?
AM : C’est le sens à donner à nos vies. Bien sûr qu’on peut être contre quelque chose dans un monde qu’on n’aime pas, le mieux pour résoudre cette conflictualité dans le monde actuel, c’est de construire l’alternative, montrer qu’elle est viable, pour nous-mêmes, pour ceux qui nous regardent, nos enfants et même tous ceux qui se demandent si un autre monde est possible. Oui, on peut le construire. À chaque fois qu’on montre une alternative, on fait la démonstration que c’est possible. C’est la résolution de la tension. Ces syndicalistes sont devenus entrepreneurs, ils ont eu raison de protester, ils ont raison de construire. Dans toute vie on a des périodes de refus, on peut être à la fois Antigone et ces princes, ces rois de micro-royaumes dans lesquels nous pouvons imposer notre forme de gouvernement, le gouvernement de nos vies. Et des millions de gouvernement de nos vies, tous différents, peuvent ensemble constituer le gouvernement d’un pays.
ST : À condition sans doute d’aider, de soutenir, de fédérer et de tisser des liens entre tous.
AM : C’est l’idée de ce podcast, qui promeut des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Les honorer et les remercier me paraît indispensable.
ST : Lors de la très remarquée et utile commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France vous avez parlé de souveraineté et de loyauté, en montrant votre attachement à ces valeurs. En quoi ont-elles à ce point du sens ?
AM : La France, c’est un pays qui a ce désir éperdu de vivre libre et indépendant. C’est d’ailleurs son histoire, c’est pour cette raison qu’elle s’est affranchie des monarques. La souveraineté est une conquête de la Révolution Française, c’est la liberté de choisir. Dans l’histoire et la géographie de la France, la liberté est une base dont nous sommes les inventeurs. C’est un mot qui n’existe pas dans certaines civilisations, comme en Chine par exemple. Ce mot a été inventé par l’Occident, et au cœur de l’Occident il y a la France, qui joue un grand rôle dans le monde. Cela fait partie de notre histoire. Donc évidemment la perte de souveraineté conduit à ce que vous soyez dans la main des autres, d’abord sur le plan économique.
Alors évidemment, dans ce cadre-là, pour construite cette liberté, on a besoin d’unité. On a besoin de concilier les contraires. Et donc pour ça la loyauté est nécessaire. Vous ne pouvez pas mettre d’accord des gens qui ne sont pas d’accord sans loyauté, c’est à dire d’accord sur l’intérêt national. Vous ne pouvez pas faire cohabiter des gens qui sont structurellement dans des situations de s’affronter, les faire coopérer, sans cette loyauté. C’est le même sujet en fait, la liberté s’accompagne de loyauté.
ST : On assiste depuis quelques années aux soubresauts d’un pays qui se construit beaucoup contre. Le premier épisode de votre podcast montre l’écart important entre l’impression que les français seraient beaucoup contre, contre les réformes, contre les projets, contre le fait d’agir, et le fait que beaucoup de gens sont actifs et au service de projets utiles, avec des objectifs précis, riche de sens. Pensez-vous qu’il y a une prise de conscience suffisante pour aujourd’hui inverser la tendance et aller collectivement un plus de l’avant ?
AM : Il y a beaucoup de gens, parmi les protestataires, qui sont eux-mêmes des entreprenants. Ils entreprennent beaucoup dans leur vie, dans les associations, dans leur métier. Il n’y a pas d’un côté ceux qui protestent et de l’autre ceux qui font, parce qu’en fait on est contre quelque chose et on est obligé d’être pour autre chose. C’est invivable d’être toujours contre, parce qu’on se détruit. Et de la même manière c’est impossible d’être toujours pour, parce que là il y a un mensonge. C’est une répartition que chacun a en soi, différente bien sûr les uns des autres. Parfois c’est 50/50, parfois c’est 5/95, 70/30, on ne sait pas. Dans chaque être humain il existe une âme bâtisseuse, comme finalement dans l’abeille, il y a l’instinct de construction. Et puisque l’être humain est un individu social, il aime coopérer avec autrui. Et que fait-on de mieux, à plusieurs, que d’essayer de faire ciller, ou de donner un coup d’épaule à l’histoire ? Le rôle des masses, autrefois théorisé par le léninisme, c’est aussi la construction par des communautés de projets qui dépassent l’individu, qui lui permettent de se réaliser. En France il existe de nombreux entreprenants, et dans la grande catégorie des entreprenants vous avez des entrepreneurs, ceux qui montent des entreprises, et ceux qui participent à la vie de ces entreprises, c’est-à-dire des millions et des millions de gens qui tous les jours construisent un outil commun. Donc je ne ferai pas la partition entre ceux qui disent non et ceux qui disent oui.
ST : Nous sommes dans une pleine phase de réindustrialisation, et aujourd’hui se tient le sommet « Chose France[3] ». Que pensez-vous de l’arrivée de capitaux étrangers en France pour notre réindustrialisation ?
AM : D’abord qui pourrait déplorer qu’il y ait des milliards qui viennent s’investir en France ? On ne peut que s’en réjouir. Mais je voudrais dire qu’il s’agit ici d’un symptôme de notre faiblesse. D’abord parce que nous avons 156 milliards de déficit annuel de commerce extérieur, c’est-à-dire que 156 milliards sortent chaque année du pays. Comme on ne produit plus ce qu’on consomme, qu’on produit beaucoup moins que ce qu’on consomme, on achète à l’extérieur, donc on a besoin qu’il y a des flux dans le sens contraire, c’est-à-dire qu’il y ait de l’argent qui rentre pour équilibrer nos impérities économiques.
Nous sommes un pays de plus en plus détenu par nos créanciers, c’est-à-dire nos investisseurs, lesquels viennent faire leur shopping dans nos entreprises, comme nous l’observons depuis maintenant quinze ans, et qui choisissent la France pour y investir. C’est un peu le côté reluisant de notre faiblesse. Et vous avez le côté beaucoup plus sombre, qui fait qu’aujourd’hui le monde entier vient acheter la France en pièces détachées parce qu’ils savent qu’on a besoin d’argent. Au fond tout ces éléments marquent une perte de contrôle de notre économie. Et un état d’urgence absolu face à notre affaissement économique.
ST : Que faudrait-il faire, ou engager, pour que la situation change ?
AM : Il faut se remettre rudement au travail, c’est le sens de la réindustrialisation. Ce n’est pas un slogan, ça ne peut même pas être un politique d’Etat, encore moins une politique d’attraction d’investissements étrangers, il faudrait qu’on soit capable de relocaliser sur le sol national entre 50 et 70 milliards de chiffre d’affaires. Voilà, vous connaissez le tarif. C’est un travail de Titan que même Jupiter ne peut réaliser seul. C’est une mobilisation nationale, une appropriation par tous les secteurs de la société, c’est-à-dire qu’il faut réformer le système bancaire, qui ne finance pas l’économie réelle. Il faut remobiliser l’épargne qui est gaspillée et qui part à l’étranger. Ça veut dire qu’il faut débureaucratiser les règles et les contraintes qui pèsent sur les entreprises, ça veut dire qu’il faut remobiliser la nation autour d’une seule cause, une grande cause nationale, qui s’appelle se remettre à produire en France. Parce que sinon on n’y arrivera pas, et nous nous appauvrirons cruellement.
ST : On a besoin d’acteurs industriels, mais nombre des décisions importantes à ce « produire en France » dépendent des acteurs politiques. Vous en avez été un de premier rang, vous êtes aujourd’hui un acteur économique, à titre privé. Avez-vous l’intention de jouer encore un rôle politique pour aider à accompagner ces changements ?
AM : Non, j’ai déjà beaucoup donné. Je considère que j’ai fait ce que je pouvais, dans le sens que j’espérais, avec des résultats qui sont contrastés. Je ne peux maintenant m’intéresser au pays qu’au travers de mes entreprises et des combats économiques qui sont les miens. C’est déjà pas si mal.
ST : Vous le savez maintenant de l’intérieur, toutes les entreprises se trouvent confrontées à des contraintes ou des lourdeurs administratives qui ne cessent de se complexifier. Que faudrait-il faire pour ne pas les fragiliser plus encore ?
AM : Je pense qu’il faut d’abord atrophier le système normatif qui vient de l’administration, qui est dépolitisée puisqu’il n’y a pas de contrôle politique sur l’administration en France, elle est en roue libre. C’est le grand problème de notre pays. Si je résume, dans un pays qui a inventé la liberté, quand même, on se retrouve dans une situation entre Kafka et Sacha Guitry, ou Alphonse Allais, qui consiste à découvrir que tout ce qui n’est pas autorisé deviendrait interdit, alors que normalement tout ce qui n’est pas interdit est de droit libre, et donc maintenant plus personne ne fait rien car se croit obligé de demander l’autorisation. Cette grave perversion du système juridique fait qu’il va falloir très rapidement imaginer une manière de se débarrasser d’une quantité considérable de règlementations qui ne sont pas seulement inutiles, mais aussi liberticides. Elle empêchent la société de prendre confiance en elle. Pour moi il faut faire confiance aux acteurs, sinon une société qui organise la défiance, qui imagine le délit derrière n’importe quelle pratique, c’est une société qui se meurt et se dévitalise. Pour ce travail de débureaucratisation il faudrait qu’il y ait au vice-premier ministre qui ne fasse que ça, pendant cinq ans. Il conviendrait de le rendre numéro deux du gouvernement, avec autorité sur tous les autres. Je pense qu’on pourrait y arriver franchement ainsi.
ST : Pouvez-vous nous en dire plus sur la maladie qu’avaient plusieurs de vos anciens collaborateurs, la bruxellose ?
AM : (Rires) Ma grand-mère dans le Morvan se plaignait du fait que ses lapins avait la myxomatose. Lorsque mes collaborateurs revenaient de Bruxelles et qu’ils me disaient qu’on ne pouvait pas faire telle ou telle chose, que la Commission Européenne n’autorisait pas telle ou telle autre chose, je leur ai répondu un jour « Vous, il faut vous soigner d’urgence, vous avez la bruxellose. Vous êtes contaminés par une maladie qui est celle de la croyance que Bruxelles va décider à notre place. »
ST : Aujourd’hui vous êtes associé dans dix entreprises, dans l’industrie et l’agriculture, deux piliers de notre pays. Que pensez-vous du fait qu’ils soient attaqués par des activistes et des militants qui, ne connaissent pas grand-chose, sont pourtant très sûrs d’eux et n’hésitent pas à conduire des actions qui fragilisent ces activités ?
AM : Les écologistes de la punition -et non de la construction- sont les conservateurs de la mondialisation actuelle, parce que le principal obstacle à l’écologie est que le lieu de production est très éloigné du lieu de consommation, il n’y a pas de lien entre le producteur et le consommateur. La première des écologies est celle qui produit sur place ce dont on a besoin. C’est la politique souverainiste. Il s’agit de réconcilier les circuits courts, par seulement dans l’alimentation mais dans tous les domaines. Faire coïncider les besoins des producteurs avec celui des consommateurs. Les écologistes qui empêchent la production sur place sont des révolutionnaires du statu quo, et les pires conservateurs de la mondialisation libérale. Finalement ils ne veulent pas qu’on extrait des mines des matériaux de la transition écologique, donc ils préfèrent faire de l’écologie sans en voir les conséquences. Ils ne veulent pas que l’agriculture, telle qu’elle est, fonctionne à un prix accessible, alors ils la rendent impraticable sur le sol national et leurs actions conduisent à l’importation. Ils empêchent tout investissement dont ils croient qu’ils porteraient atteinte à leurs principes alors qu’en vérité il sont des moyens de recréer des capacités de production sur place. On voit bien que cette écologie-là est l’écologie du statu quo, celle qui fait reculer le monde, alors qu’on a besoin de faire grandement progresser l’écologie.
Par ailleurs je regrette une chose, qu’il n’y ait pas de débat sur tous les sujets techniques et scientifiques, parce que la science est totalement instrumentalisée et manipulée. J’ai cherché des médias qui traitent les problèmes et les dossiers sur le fond, mais il n’y en a pas dans les grands médias. Nous avons un soucis de débat public. Je ne suis pas contre qu’on débatte des bassines, et on va découvrir que 70% des bassines sont indispensables, et que peut-être 30% d’entre elles sont indésirables.
ST : Dans les deux premiers épisodes de votre podcast chacun partage son expertise, tous les aspects d’un sujet sont abordés, politiques, techniques, scientifiques, emploi, … Il répond donc à ce que vous attendiez.
AM : J’ai voulu donner la parole à des gens extraordinaires qui n’ont aucune chance d’être entendus dans le système médiatique actuel. C’est une espèce de contre-société de faiseurs, ou plutôt de faiseux, des gens qui travaillent, qui construisent, selon des principes et des valeurs qui sont parfaitement identifiables, et qui concrétisent des projets. Évidemment cela suppose de croiser tous les domaines, écologie, sciences économiques, sociétal, les besoins de la société, les choix politiques, ce sont des démonstrateurs qu’il est possible de faire des tas de choses dans notre pays qui est peuplé de gens formidables, c’est tout ce que j’aime.
ST : Vous dites faiseux plus que faiseurs ?
AM : Oui, parce que faiseur c’est négatif. Le faiseux c’est celui qui fait, car dans mon pays natal on disait : « il y a les faiseux et les diseux ».
ST : Et alors, Monsieur Montebourg, qui sont donc les Vrais Souverains ?
AM : Les Vrais Souverains, ce sont ceux qu’on n’entend pas, mais qui font beaucoup pour reconstruire la France. C’est une société qui est liée par des liens invisibles, des liens de solidarité et d’entraide, composée de gens qui ne se connaissent pas. J’ai décidé qu’ils se donnent la main dans un lieu où ils pourront se découvrir les uns les autres. C’est ma contribution au débat public, une mise en valeur de nos efforts extraordinaires.
[1] Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
[2] Arnaud Montebourg part à la rencontre des Vrais Souverains, ceux qui se lèvent pour construire une France libre et souveraine, indépendante car elle prend son destin entre ses mains.
[3] Sommet instauré par le président Emmanuel Macron qui vise à présenter et expliquer aux grandes entreprises internationales les réformes menées pour favoriser l’activité économique de notre territoire. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/choose-france
⭕️ Mezze de tweets
🆘 "La France n'est plus propriétaire d'elle-même !"
Jean-Marc Daniel, @bfmbusiness, 15/05/23 #ChooseFrance pic.twitter.com/MFNgKaUqal— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 15, 2023
@SouveraineTech est maintenant hébergé en @regionbretagne chez @icodia et nous en sommes FIERS ! Retenez bien ce nom, vous allez en entendre parler ! Et, oui, ça a du sens pour nous d'être hébergés et si bien accompagnés à Rennes plutôt qu'à Roubaix. MERCI Émeric et Raphaël ! 🙏 pic.twitter.com/9JF2XgRvC2
— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 18, 2023
#HP désactive à distance les imprimantes qui utilisent des cartouches rivales.https://t.co/XSHkZJQxMv
— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 17, 2023
Peut-on se mettre d'accord une bonne fois pour toutes sur le fait qu'attirer l'investissement des grands groupes étrangers sur notre sol, ça n'est PAS réindustrialiser notre pays ? https://t.co/1sh4cGEhPi
— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 14, 2023
"Le département américain de la Défense abandonne l'un de ses plus anciens programmes de cybersécurité protégeant son vaste réseau informatique mondial, et le remplace par des outils #Microsoft, malgré l'opposition interne et les critiques des experts."https://t.co/NT8XBBCnbw
— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 18, 2023
Dans un article publié par The Conversation, @AdrienTallent, doctorant en philosophie politique et éthique, s'intéresse à l'impact des algorithmes sur notre système politique et au risque d'instauration d'une nouvelle société du contrôle.https://t.co/k62zMmVLCT
— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 18, 2023
#Microsoft s’offre le droit de polluer en achetant des millions de crédits carbone.https://t.co/i5bckUxE5d
— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 17, 2023
De l’urgence à réhabiliter la "souveraineté" ! https://t.co/k3YJ67ZO1E
— Souveraine Tech (@SouveraineTech) May 17, 2023
💥 Après le #DA, le #DSA, le #DMA, le #MICA ou encore l'#AIA, le président de @Whaller, @faure_t appelle solennellement @ThierryBreton à l'édiction d'un #DFA : un "Digital Fighting Act" ! 🥊https://t.co/ROtea7FX6P
— Whaller (@whaller_fr) May 17, 2023
⭕️ Hors spectre

“Être bon représente une aventure autrement violente et osée que de faire le tour du monde à la voile.”
G.K. Chesterton