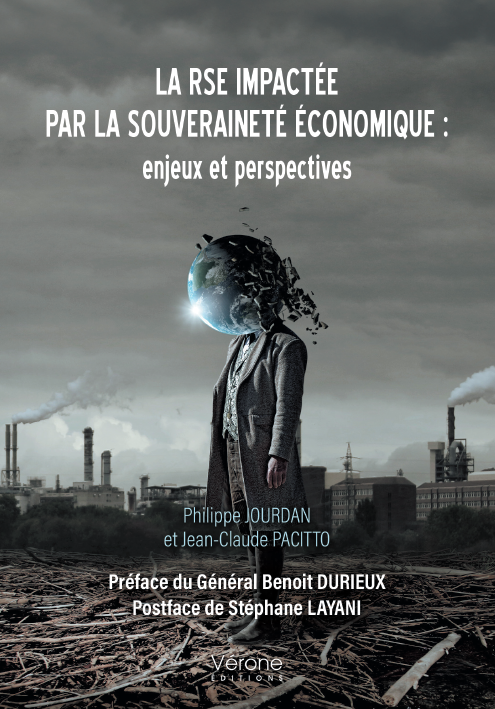Avertissement : Souveraine Tech revendique par vocation une approche transpartisane. Seule nous oblige la défense des intérêts supérieurs de notre pays. Nous proposons ainsi un lieu de « disputatio » ouvert aux grandes figures actives de tous horizons. La parole y est naturellement libre et n’engage que ceux qui la prennent ici. Cependant, nous sommes bien conscients des enjeux en présence, et peu dupes des habiles moyens d’influence plus ou moins visibles parfois mis en œuvre, et dont tout un chacun peut faire l’objet, ici comme ailleurs. Nous tenons la capacité de discernement de notre lectorat en une telle estime que nous le laissons seul juge de l’adéquation entre le dire et l’agir de nos invités.
Vendredi 23 février 2024
Aurélie Luttrin est ancienne avocate, membre du Cercle K2 et fondatrice du cabinet EOKOSMO qui aide les secteurs public et privé à atteindre leurs objectifs de performance globale (technologique, économique, écologique et sociale) dans le contexte de la 4ème révolution industrielle en proposant et en mettant en œuvre des stratégies pluridisciplinaires à impact.
1/ Quel regard portez-vous sur la situation actuelle de notre pays à tous égards ?
Il faudrait presque écrire un livre à ce sujet tellement j’ai de choses à dire sur la situation de notre pays mais si nous devions résumer cela en un deux mots : déliquescence organisée.
Nous subissons plus de 15 années de captations massives de données dont le résultat aujourd’hui est le déferlement d’IA génératives accroissant exponentiellement l’affaiblissement de la France qui subit plus qu’elle n’agit véritablement, France qui a le statut officiel de vache à lait de nombreuses puissances concernant deux matière premières fondamentales dans la cyberguerre et la course vers le monopole de l’IA : les données et les cerveaux.
La population n’est pas prête à affronter la 4ème révolution industrielle car 98% de la population ne connaît pas cette 4ème révolution industrielle et tous les enjeux qu’elle implique. Ignorance qui participe au pillage en masse de la France.
Alors que la troisième révolution industrielle se réfère au développement de l’électronique et des technologies informatiques, la quatrième révolution industrielle, quant à elle, est un véritable « tsunami technologique » lié à l’exploitation des données et au développement de l’intelligence artificielle.
« Il faut rendre l’humanité attentive aux grands bouleversements que la quatrième révolution industrielle va provoquer. La quatrième révolution industrielle bouleverse notre société dans ses fondements » (Klaus Schwab, Fondateur du World Economic Forum, 8 Janvier 2016, Le Temps), « Avec [cette] révolution industrielle, le pouvoir réside désormais dans la détention de la donnée et non plus dans la détention du capital » (La transformation numérique, s’adapter ou disparaître, Thomas M.Siebel)
Comme je l’ai souvent souligné avec Franck De Cloquement lors de nos tribunes communes, chaque jour, avec nos smartphones, nos ordinateurs, nos objets connectés, l’ensemble des capteurs déployés dans nos entreprises, dans nos réseaux, dans nos lieux d’habitation, nous générons à l’échelle mondiale plus de 2,5 trillions d’octets de données. Quand nous découvrons que nous disposons de trois fois plus d’objets connectés (IOT) que d’êtres humains sur la surface de notre planète, nous réalisons très vite que notre monde physique voit peu à peu advenir l’émergence de son « jumeau », tel un véritable double numérique.
Ainsi, tout comme nos bâtiments connectés produisent des données retraçant leur mode de fonctionnement, chaque être humain connecté produit un avatar numérique qui duplique au sens propre sa vie réelle, avec à la clef l’accès à ses plus intimes secrets. Elon Musk, fondateur de TESLA, prédisait lui-même il y a quelques années que « dans 25 ans, il y aura plus de nous dans le Cloud que dans notre corps ». Nous y sommes.
Les premiers à l’avoir compris sont les États-Unis et la Chine, et dans leurs sillages, leurs très nombreux chevaux de Troie que sont les GAMMA (Google Amazon Meta Microsoft Apple – je préfère l’acronyme GAMMA à GAMAM car comme les GAMMA GT, quand ils prennent trop de place, c’est le corps entier qui dysfonctionne) et les BATXH (Baidu Alibaba TenCent Xiaomi Huawei).
En effet, tous ces mastodontes géopolitiques ont très vite saisi que les pouvoirs politique et économique résidaient désormais dans la maîtrise des jumeaux numériques : maîtrisez les données des hôpitaux, des entreprises, des citoyens, des administrations, des services publics, c’est maîtriser l’adversaire géopolitique et le concurrent économique. L’annexion ne sera pas territoriale cette fois, mais l’effet produit sera tout aussi catastrophique.
Ce monopole de la donnée est parfois renforcé par la réglementation, comme c’est actuellement le cas aux États-Unis, en Chine (Nouvelle Route de la Soie, Loi sur la sécurité nationale…), en Russie. À cela se greffe également le transhumanisme (la volonté de dépasser les limites de l’Homme dont la mort), le libertarisme, philosophie économico-politique, qui se base sur une détestation de l’Etat, des services publics et de la concurrence car constituant des freins à la croissance économique. Culte de l’individualisme, ultra-libéralisme, dont sont des fervents défenseurs les dirigeants de la Silicon Valley, comme Jeff Bezos, Elon Musk, Peter Thiel et consorts. Si nous appliquons leur vision politique, qu’ils mettent en œuvre, chaque jour, à travers leurs différents produits et services, l’Homme n’a qu’un seul but : produire toujours plus, seule une élite d’ultra-riches bénéficiera des avancées technologiques au détriment d’une masse d’inutiles vouée à disparaître puisqu’à l’avenir, nous serons amenés à ne produire que des êtres humains augmentés dont nous aurons besoin qui vivront sur une autre planète, la Terre étant vouée à disparaître.
Délires mégalomaniaques pour certains, maîtrisés par l’Etat américain pour l’instant qui brandit régulièrement la loi anti-trust en cas de dérapage mais au final cette vision gagne du terrain sur tous les pans et s’exporte (mise à mal des services publics, affaiblissement des Etats….). Nous nous rendons compte que ne pas maîtriser la psychologie des différents interlocuteurs de la Tech c’est conclure des contrats en notre défaveur, choisir des technologies mortifères et perdre la bataille voire, à terme, la guerre.
En France, nous avons une intensification des fuites de données et de cerveaux avec des pépites technologiques qui passent sous pavillon américain.
Quand on voit qu’EDF choisit AWS pour la maintenance prédictive des pièces détachées des centrales, que Le Monde et SIPA Ouest-France sont fiers d’annoncer leur accord avec Microsoft pour les aider à appliquer les fonctionnalités de l’IA générative, que la French Tech Grand Paris est fière d’annoncer l’ouverture d’un centre de recherche par Google (et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres), nous ne pouvons qu’être désabusés.
En réalité, nous sommes à un carrefour, avec deux choix encore possibles (mais nous n’aurons bientôt plus le luxe de choisir à ce rythme) :
- la vassalité permanente (facile, peu d’énergie, on laisse couler le navire et s’en sortiront ceux qui pourront)
- l’indépendance (stratégies multiples et concomitantes à 360°, développement d’une pensée complexe (et pas compliquée) tri-temporelle (court, moyen et long termes) , macro/micro, choix de nouveaux profils engagés dans la défense de l’intérêt général, revenir aux fondamentaux du service public , à savoir la satisfaction des besoins des usagers, beaucoup d’énergie pour mettre au pas tous les écosystèmes afin qu’ils servent tous la politique d’Etat).
Pour ma part, même si beaucoup me disent que le combat est vain, je ferai toujours le choix de l’indépendance et me battrai à mon petit niveau pour la conserver au maximum, à travers les conseils que je donne et que j’applique.
2/ Il semble que l’Union européenne exerce en ce moment un certain appel d’air sur la question de la souveraineté. De quel œil voyez-vous cela ?
Parler de souveraineté européenne est un peu incongru dans la mesure où l’Europe n’est pas un État et qu’elle ne dispose pas de cette souveraineté. Mais que l’Europe s’inquiète de la défense des intérêts européens et de tout ce qui pourrait porter atteinte à la souveraineté des États membres, je vois cela d’un très bon œil ….
Même si l’Europe souffre du même syndrome que la France, celui du « en même temps ». Là aussi, il manque une colonne vertébrale qui permettrait d’adopter une stratégie claire, sans compromis sur la question de la souveraineté.
Nous adoptons le RGPD mais en même temps nous acceptons les GAMMA dans le projet, avorté dans l’œuf, GAIA-X (présenté comme le « premier pas » vers une « infrastructure européenne du cloud).
Nous adoptons une réglementation qui est une première mondiale sur l’IA le 2 février 2024, mais en même temps le 10 juillet 2023, la Commission européenne adoptait une nouvelle décision d’adéquation concernant les États-Unis. Par cette décision, la Commission a décidé que les modifications apportées par les États-Unis à leur législation nationale permettent désormais d’assurer un niveau de protection adéquat des données personnelles transférées de l’UE vers les organisations situées aux États-Unis alors que ces derniers ont renforcé leur législation sur la sécurité nationale et les systèmes de captation des données.
En Europe, nous avons également trop de trous dans la raquette qui laissent passer des ingérences étatiques diverses quel que soit le domaine d’intervention : Qatar, Etats-Unis, Chine … Nous avons l’impression parfois que l’Europe est une grande passoire quand il s’agit d’être ferme sur la défense des intérêts du bloc européen.
Mais existe-t-il réellement un bloc européen ? C’est peut-être cela qu’il faut définir. Là encore, il manque une stratégie claire, ferme et une coordination cohérente des actions de toutes les institutions européennes.
3/ L’avocate que vous êtes peut-elle nous parler de l’article 411- 6 du code pénal et évaluer le « manque à incarcérer » que nous accusons en France en la matière ?
Ancienne avocate, je précise, puisque je suis sur le tableau des omissions, mais il n’en reste pas moins que j’ai un avis sur la question.
L’article 411-6 du code pénal dispose que « le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 € »
Par intérêts fondamentaux de la nation, il faut comprendre, selon l’article 410-1 du code pénal , « son indépendance, l’intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et les éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel »
Ainsi, pour tout choix technologique tendant à transmettre des données sensibles à une puissance étrangère via l’application d’un droit extraterritorial et portant atteinte aux secrets des affaires, industriels (atteinte à la stratégie économique de la Nation) , secrets politiques ou accroissant le risque d’attaques cyber (données personnelles de santé) et provoquant l’affaiblissement du pays, il pourrait être possible de plaider l’atteinte aux droits fondamentaux de la Nation.
Cet article confirme qu’un choix technologique est un choix politique qui ne doit pas être entièrement délégué aux DSI. Il s’agit désormais d’une nouvelle responsabilité des dirigeants (d’entreprises, de territoires….). Cependant, pour que cet article soit appliqué et participe à l’éducation du plus grand nombre, encore faut-il une politique pénale qui aille dans ce sens ainsi qu’une acculturation des magistrats sur le sujet, toutes juridictions confondues (judiciaires et administratives). D’où l’importance d’organiser de nouveaux modules de formation à l’ENM, l’INSP, au sein des écoles de police pour avoir une politique pénale cohérente et surtout un gouvernement qui prenne le sujet à bras le corps.
Cet article n’est pas suffisant et mériterait d’être complété par tout un bloc législatif et réglementaire pour sanctionner différents types d’atteintes aux intérêts (et pas seulement fondamentaux) de la Nation (limitation de la participation de certains représentants de puissances étrangères ou d’entreprises étrangères liées à ces puissances aux syndicats professionnels, think tanks, universités, grandes écoles, encadrement des subventions et des investissements, renforcement de la législation sur les opérations d’achats d’entreprises stratégiques par des puissances étrangères, encadrement des choix technologiques dans les secteurs sensibles, établissement d’un bloc de sanctions afférant à toutes ces nouvelles limitations…. ).
4/ Comment évaluez-vous le degré de maturité des collectivités sur la question de la protection et de la valorisation des données des populations qu’elles administrent ?
Faible et d’ailleurs la délégation parlementaire au renseignement l’a souligné dans son rapport annuel 2023 publié en janvier 2024.
Un trop grand nombre de collectivités pensent que les questions de souveraineté numérique, d’intelligence économique sont des préoccupations bien loin de leurs préoccupations quotidiennes.
J’ai même eu dans le cadre de mon activité des RSSI, des DSI qui n’ont pas hésité à me dire que si Joe Biden captait des données de Monsieur et Madame Dupont ce n’est pas bien grave , ils ne voyaient pas qui cela pourrait véritablement intéresser (sic). Donc là évidemment, nous partons de très loin.
Trop de collectivités encore cantonnent la « smart city » , terme que j’ai d’ailleurs en horreur tellement il a été galvaudé…., à la pose de capteurs, l’utilisation de technologies peu importe leur origine sans savoir comment ces technologies fonctionnent et sans savoir que désormais un choix technologique est un choix politique.
C’est ainsi que nous avons eu le Maire de Valenciennes qui a bénéficié de la fourniture gratuite de 230 caméras et qui décide de renoncer au cadeau mais pas en raison de la mise en garde de la CNIL. « Huawei se retire, mais si Huawei était resté, on aurait continué. On ne renie absolument pas ce partenariat » (Voix du Nord – 5 août 2022).
Notons que la loi chinoise sur la sécurité nationale impose à Huawei, la transmission de toutes les données captées au parti communiste chinois.
Nous avons également des DSI qui prennent tous les packs Microsoft, utilisent à foison PowerBI, des collectivités qui sélectionnent des opérateurs leur proposant des technologies non souveraines et/ou qui vont capter et réutiliser à leur propre compte les données territoriales en privant lesdites collectivités d’une source de revenus supplémentaires. À cela s’ajoute, tous les Think Tanks, les salons professionnels destinés aux élus comme le salon des Maires où figurent des technologies mortifères pour nos territoires. À la décharge des élus et opérationnels, il y a de quoi perdre son latin devant autant de signaux contradictoires et autant de manque de cohérence, surtout que nous retrouvons ce manque de cohérence au niveau de l’Etat.
Trop de collectivités ne saisissent pas qu’il faut désormais entrer dans une nouvelle ère de la gestion territoriale qui nécessite de nouvelles stratégies pluridisciplinaires (contractuelles, économiques, sociales, écologiques), un nouveau management, de nouvelles procédures, des nouveaux profils, des technologies souveraines et une cybersûreté (plus large que la cybersécurité qui prend en compte la sécurisation des usages et une mise à niveau des équipes sur les enjeux de la 4ème révolution industrielle).
Les collectivités ont des leviers de croissance énormes qui sont inexploités à ce jour.
Ce qui est malgré tout rassurant (les collectivités peuvent s’en sortir financièrement et socialement si de nouvelles méthodes sont appliquées). Il est donc urgent d’acculturer les collectivités territoriales sur les véritables enjeux et les stratégies à déployer pour se sortir du marasme économique et technologique dans lequel nous nous trouvons. Et ce n’est pas quelques heures de formations délivrées en Préfecture comme le préconise la délégation parlementaire au renseignement qui va régler le sujet. Le secteur privé n’est pas en reste. Il souffre des mêmes maux que le secteur public. Ne jetons pas l’opprobre sur les collectivités. Le manque d’acculturation est général.
5/ Sur les parfums de souveraineté dont s’aspergent de scabreuses associations d’entreprises françaises et américaines, comment analyser le fait qu’elles mettent en avant le degré de protection assuré par la France et l’excellence technique américaine ? N’est-ce pas pour notre pays se tirer une double balle dans le pied ?
Je dirais que nous avons là l’application topique de la politique du « en même temps », qui a ses limites…. Capgemini et Orange s’associent pour créer une offre de cloud souverain dénommée BLEU, avec (roulement de tambours….) Microsoft. J’imagine bien les tempêtes de cerveaux au sein de ces deux mastodontes et cela pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une série humoristique digne de The Office si les enjeux n’étaient pas si graves. En effet, de compromis à compromission il n’y a que quelques lettres de différence et parfois cela ne tient qu’à un fil de basculer du côté obscur de la force.
La paresse chronique dont souffre une grande partie de nos écosystèmes politique et économique conduit à ce genre de discours. Il est plus facile de renoncer et de tout transmettre à la Chine ou aux Etats-Unis plutôt que de déployer des stratégies holistiques, pluridisciplinaires nécessitant une vision à 360° que peu ont, pour contrer les attaques de ces superpuissances, puissances qui d’ailleurs nous respecteraient un peu plus si nous étions plus combatifs dans la défense de nos propres intérêts. La démission totale de la France en la matière paraît inconcevable pour un œil américain ou chinois. D’ailleurs en Chine et aux Etats-Unis, cette politique du « en même temps », « on n’a pas le choix », « cédons nos secrets industriels, étatiques à des puissances étrangères » serait pénalement sanctionnée. Et à ceux qui disent « c’est compliqué » et « c’est déjà trop tard », j’opposerai cette citation de l’Abbé Pierre : « on ne peut pas sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire. »
6/ Bernard Benhamou raconte qu’on disait avant « personne n’a jamais été viré pour avoir acheté IBM » et qu’on dit la même chose aujourd’hui au sujet de Microsoft. Que dira t-on demain selon vous et pour quelles raisons ?
Avant, il n’y avait pas le CLOUD Act.
Avant nous n’étions pas dans une cyberguerre.
Avant, nous étions encore au stade de la troisième révolution industrielle.
Avant un choix technologique n’était pas un choix politique.
Nouveau monde, nouvelles mœurs, nouvelles règles…
Il va falloir revoir le code du travail, le code de la fonction publique, comme le code pénal, pour sanctionner des mauvais choix technologiques allant à l’encontre des intérêts de la Nation.
Demain, j’espère que nous dirons que même si nous avons commis des erreurs, nous avons su réagir à temps pour conserver notre indépendance et reconstruire le pays sur de bonnes bases en revenant aux fondamentaux de notre puissance : un projet d’avenir et une stratégie claire pour y parvenir, un système éducatif d’excellence, la relance de l’ascenseur social, une population agile et innovante dont l’employabilité est garantie, des entreprises stratégiques protégées par un Etat conscient de la valeur de ses pépites technologiques et industrielles, un Etat garant des intérêts de la Nation qui sait négocier avec les autres puissances étrangères et conclure des alliances équilibrées, une agriculture souveraine en pleine relance….
7/ En France tout le monde ou presque, semble sur le pied de guerre en matière de cybersécurité mais si vous parlez de guerre économique, il y a statistiquement quelques chances que vous soyez pris pour un mythomane ou un paranoïaque. Comment changer quelque chose ?
Avec un plan Marshall de l’Education Nationale doublé d’un bloc législatif et réglementaire sanctionnant fermement toute action qui irait à l’encontre des intérêts de la France. En termes clairs, Education et Sanction.
Ceux qui veulent comprendre auront ainsi l’Education nationale pour satisfaire leurs besoins intellectuels, pour les autres il y aura la sanction. Nul n’est censé ignorer la loi. Nous éviterons ainsi des débats stériles avec ceux qui ne veulent pas comprendre et cela insufflera un vent de discipline sur le sujet dans un pays qui en manque cruellement en la matière. Comme nous l’avons déjà souligné précédemment, le principal problème en France est cette méconnaissance généralisée des enjeux de la 4ème révolution industrielle et de l’incapacité chronique des entreprises, administrations, collectivités territoriales à changer leur mode de fonctionnement qui correspond à un temps révolu, qui n’existe plus.
Cette méconnaissance contribue à créer la crise économique que nous subissons au profit d’autres puissances qui elles ont bien compris les nouvelles règles du jeu. Prenons par exemple dans la grande distribution, le cas d’école du Groupe Casino qui de décisions en décisions (notamment celle de conclure un accord avec Amazon qui a laissé rêveur plus d’un connaisseur des Big Techs ) a vu son statut passer de fleuron de la grande distribution à un opérateur en crise liquidant ses actifs.
D’autres exemples me viennent à l’esprit : des professeurs d’université ou de lycées qui s’enorgueillissent d’utiliser ChatGpT avec leurs élèves sans leur apprendre ce qui se cache derrière cette IA générative, et tous les sujets géopolitiques qu’elle soulève.
De même, des influenceurs tech, faisant la promotion d’une myriade de technologies dangereuses pour la sécurité nationale, se multiplient à vitesse grand V en s’auto-proclamant experts et donnent des conseils malheureux à leur audience nombreuse.
Ne pas anticiper l’impact des intelligences artificielles sur notre société, les emplois des Françaises et des Français, ne pas œuvrer pour garantir leur employabilité, est catastrophique car générateur, à terme, d’un chômage de masse structurel. Il n’y aura pas de destruction créatrice schumpetérienne avec l’IA. En outre, ne pas vouloir encadrer l’IA, comme nous avons encadré la recherche médicale avec les lois bioéthiques, conduira également à un massacre social avec la multiplication d’algorithmes et d’intelligences artificielles discriminantes, non contrôlées, générant un déterminisme des injustices sociaux sans précédents pouvant déstabiliser notre démocratie. Sur ce sujet, nous avons heureusement le règlement européen en date du 2 février 2024 mais il faudrait aussi se saisir du dossier au niveau national et compléter le bloc réglementaire européen.
Le déterminisme social, le sexisme systématique lié à l’application d’algorithmes mal conçus, remplis de biais, existent déjà aux Etats-Unis et est dénoncé par de nombreuses associations. J’invite le plus grand nombre à lire les ouvrages de Cathy O’Neil et de Caroline Criado Perez sur le sujet. Ils sont assez édifiants et nous permettent de tirer des leçons des erreurs qui ont déjà été faites. Or, aujourd’hui nous ne tirons pas les leçons des erreurs faites aux Etats-Unis , nous les reproduisons en nous américanisant. « L’ignorance est mère de tous les maux ». C’est donc en combattant cette ignorance que nous pourrons construire notre puissance .
Répondre aux enjeux de la 4ème révolution industrielle, c’est tout d’abord former des citoyens éclairés capables de décider en pleine conscience, d’être maîtres de leur destin et de conserver leurs libertés. En ce moment, ceux qui décident pour eux de leur destin, ce sont essentiellement les gouvernements américains, chinois. Pour permettre à la population de reprendre le pouvoir, il faut, dès le plus jeune âge, que les futurs actifs et acteurs de la France soient armés afin de vivre pleinement la vie qu’ils souhaitent mener sans que d’autres la leur imposent. Cela implique de nouveaux enseignements en matière de savoir-être : miser sur le travail collaboratif, éviter le culte de l’individu et de la note (syndrome du stylo rouge qui conduit à produire des cadres dirigeants par la suite qui ont peur de prendre une décision et d’échouer). La valorisation de l’échec crée une population plus dynamique, plus encline à innover.
Ensuite concernant les connaissances de fond : la géopolitique des données, les relations internationales à l’aune de la cyberguerre, la philosophie dont le transhumanisme, l’Histoire, la littérature et les sciences doivent être renforcés. Pourquoi à la fois les matières littéraires et scientifiques ? Car « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », écrivait Rabelais.
Et nous le voyons tous les jours. Il faut former des ingénieurs éthiques et responsables tout comme il faut former des juristes, des artisans, des agriculteurs, des industriels, peu importe le métier, qui connaissent les clés de fonctionnement de cette révolution industrielle et comprennent ce qui se cache derrière des technologies qui ne sont plus des gadgets informatiques mais de véritables armes politiques. Chacun est acteur de la sécurité nationale et toute la population doit être formée aux nouvelles règles de fonctionnement du monde actuel.
Cela implique une refonte totale des modes d’apprentissage, des contenus mais aussi de la formation continue car contrairement aux autres révolutions industrielles, il est fini le temps où nous pouvions nous reposer sur nos acquis pendant 15-20 ans. La formation doit faire partie de notre ADN. Cette révolution industrielle exige humilité et remise en question permanente.
Les syndicats devront également évoluer et accompagner les secteurs de l’économie dans cet apprentissage et ce décodage. Quand on voit des Big Tech au MEDEF, on se dit que la tâche va être rude mais ne désespérons pas… Nous constatons donc qu’il ne faut pas juste faire de la cosmétique en faisant de la sensibilisation au cyberharcèlement dans les collèges et les écoles. Il faut bien plus que cela et repartir d’une feuille blanche pour construire un nouveau système éducatif en phase avec les besoins des Françaises et Français et de pouvoir les protéger tout au long de leur vie.
À cela s’ajoute un bloc législatif et réglementaire nécessaire pour protéger les intérêts de la France. Il est désormais primordial de responsabiliser et de sanctionner tous ceux qui choisiraient des technologies mortifères allant à l’encontre des intérêts de la France ou qui soutiendraient financièrement des puissances étrangères en donnant des subventions à des Big Tech chinoises ou américaines.
Toutes les institutions françaises doivent servir les intérêts de la France : BPI, investisseurs français, banques, universités, grandes Ecoles, think tanks, syndicats, entreprises françaises, collectivités territoriales , Etat ….
Pour ce faire, nous devons nous doter du même arsenal juridique que les Etats-Unis pour pouvoir commencer à négocier à égalité, ce qui implique de construire un droit extraterritorial par application du parallélisme des formes. Le droit comme levier de performance économique, sociale et écologique, est assurément la piste à suivre si nous voulons retrouver notre indépendance et ça commence d’ailleurs par la renégociation de nombreux contrats et concessions conclus par des chefs d’entreprises, des collectivités territoriales avec des prestataires technologiques, des concessionnaires (eau, transports….) qui sont rarement à leur avantage.
8/ Que vous inspire la proposition « en vogue » de remplacer le vote à l’unanimité par un vote à la majorité qualifiée (VMQ) pour les questions de politique étrangère et de sécurité au Conseil de l’UE ?
Les démocraties modernes ont fait du vote à la majorité un principe de fonctionnement. Si nous revenons aux intentions des Pères fondateurs de l’Europe, il était question à l’origine de créer une simple association d’Etats européens pour éviter une autre guerre et protéger la démocratie en Europe. Avec le Traité de Rome du 1957, cette association s’est structurée avec une reconnaissance d’un pouvoir supranational tout en conservant la colonne vertébrale des Etats qu’est leur souveraineté.
Les différentes institutions européennes se sont construites avec cette idée de plus de démocratie et moins de bureaucratie, surtout ces dernières années avec un euroscepticisme grandissant et une perte de confiance. Dans le dernier eurobaromètre, seuls 35% des Français ont confiance dans les institutions européennes. On accuse aujourd’hui et parfois à juste titre, les fonctionnaires européens, les représentants des gouvernements comme étant parfois hors sol, déconnectés du terrain, d’avoir un tableur Excel à la place du cerveau, d’être facilement influençables face aux lobbyistes en tout genre dont ceux qui sont extérieurs à l’UE. Et en parallèle, l’urgence d’avoir une Europe forte, capable de contrer les actions américaines et chinoises est bien là, et ce, sur tous les fronts (crises écologique, économique, sociale, sécuritaire, technologique). Le débat sur le vote à majorité qualifiée me semble un faux problème ou du moins pas forcément la priorité du moment pour régler toutes les urgences en cours.
L’Europe prend l’eau et est la proie d’actions de déstabilisation de tous les côtés dans un contexte de cyberguerre dont tous les Etats dont le nôtre n’ont pas véritablement pris conscience ou ne veulent pas prendre conscience de l’ampleur. Aujourd’hui la règle de l’unanimité en matière de sécurité peut être un rempart contre de telles actions de déstabilisations extérieures. Prenons comme exemple, le Danemark qui est devenu, au fil du temps le poste d’écoute de la NSA en Europe et qui a signé le 19 décembre 2023, un traité avec les Etats-Unis autorisant le stationnement de troupes américaines sur son sol. Si nous n’avions pas, pour des sujets aussi structurants, que la sécurité, les règles d’entrée à l’UE, une unanimité, il serait encore plus facile pour certains pays extérieurs à l‘UE d’influencer les votes afin de conserver leur propre puissance et d’affaiblir l’Europe.
Pour que l’Europe démocratique telle qu’on la souhaite, devienne réalité, il faut à mon sens tout d’abord mener un grand chantier de reprise en mains du pouvoir et de lutte contre le lobbying, les compromissions en tout genre qui portent atteinte aux intérêts des nations européennes.
Il faut rétablir la confiance entre l’Europe et les Européens pour construire une Europe forte, garante de la pérennité des démocraties et capable de se protéger militairement et technologiquement.
L’intérêt des européens et la satisfaction de leurs besoins doivent retrouver leur place dans la politique européenne. Rien que dans le domaine technologique, le secteur des Big Tech a dépensé pas moins de 113 millions d’euros en lobbying auprès de l’Union européenne en 2022, une augmentation de 20% par rapport à 2021. Meta, la maison mère de Facebook, et Apple sont respectivement numéro un et numéro deux des dépenses de lobbying à Bruxelles tous secteurs confondus. Ce lobbying a contribué à tuer l’écosystème Tech européen mais pas que …. Ce sont nos économies respectives, nos droits sociaux, l’écologie qui sont également en péril.
L’Europe ne doit pas conduire à créer des citoyens de seconde zone, les grands oubliés de l’Europe qui n’ont qu’à subir des règles parfois incompréhensibles ne répondant plus aux besoins des européens (comme dans le secteur agricole). Reprenons comme exemple, l’accord surprenant conclu le 25 mars 2022 sur le transfert des données personnelles aux États-Unis alors même que les Américains n’ont pas changé leur réglementation en matière de captation de données, et qu’au contraire, ils l’ont même renforcée au mépris total du droit des Nations européennes.
Toutes ces actions conduisent de nombreux Européens à se dire que l’Europe n’œuvre pas dans l’intérêt des nations mais dans l’intérêt d’une élite politique. Le débat devrait donc se porter sur la probité des institutions, la compétence des représentants nationaux et la construction d’une politique claire, ferme et sans compromis pour une Europe forte, porteuse d’une troisième voie diplomatique, économique, sociale et écologique.
9/ Le souverainisme constitue-t-il une dérive sectaire ?
Si l’on définit le souverainisme comme une doctrine politique prônant l’indépendance d’une nation, son autonomie et plus largement comme la défense des intérêts de la Nation (qui incarne cette souveraineté), alors non il ne constitue pas une dérive sectaire. Il est salutaire. Le souverainisme n’est ni plus ni moins que l’application de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Le souverainisme, du moins tel que je l’entends, est la doctrine politique qui veille à ce que le peuple garde une capacité d’action via ses représentants. Toute institution (nationale, européenne a besoin de garde-fous pour éviter les dérives).
Etre souverainiste ne signifie plus être contre l’idée d’une Europe. Par les temps qui courent, l’union et l’intelligence collective sont indispensables, elles constituent d’ailleurs une troisième voie pour rééquilibrer un monde qui se bipolarise et qui tend à l’imposition de monopoles sino-américains. Le souverainisme nouvelle génération si j’ose dire, c’est le retour aux fondamentaux, la lutte farouche contre tout ce qui pourrait nuire à la capacité d’action de la Nation et de ses représentants. Elle englobe la défense de la souveraineté alimentaire, industrielle, numérique…). La nouvelle réglementation sur l’IA est la preuve qu’heureusement, il y a l’Europe pour protéger les populations quand les Etats sont défaillants…..
Attention, il ne s’agit pas non plus de confondre souverainisme et nationalisme qui conduirait à privilégier tout ce qui vient de France. Entre un BATX qui capte des données territoriales en vue de les transmettre au Parti Communiste Chinois et une entreprise française concessionnaire de transports qui capte les données des territoires pour faire des algorithmes et les revendre aux mêmes territoires, il n‘y a pour moi aucune différence, les deux sont à combattre, pour des raisons différentes certes, mais les deux conduisent à l’appauvrissement des territoires et l’appropriation indue de données. En matière de souverainisme, il n’y pas de compromis à avoir et tout compromis est a minima un échec voire dans certaines situations de la lâcheté conduisant à une compromission.
10/ Pourquoi nos pouvoirs publics se réjouissent-ils à ce point du fait que Google ou ses homologues investissent en France ?
Selon les personnes qui interviennent, il y a de l’ignorance, de la naïveté, du cynisme, de la paresse, de la méthode Coué et de la franche compromission. Tout ce savant mélange fait que sur chaque photo diffusée sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels, nous remercions chaleureusement nos bourreaux avec un sourire béat avec des journalistes qui, le plus souvent, ne se posent pas les bonnes questions. Ne plus avoir d’espoir, abandonner la partie quand on aime la France et quand on est attaché au sort de sa population, c’est se résigner et je ne me résigne jamais. Alors oui, cela m’a causé certains soucis mais je garde à l’esprit deux citations :
« Celui qui n’a pas le goût de l’absolu se contente d’une médiocrité tranquille ». Paul Cézanne
« Tout ce qui s’est fait de grand dans le monde est fondé sur l’espoir ». Martin Luther King